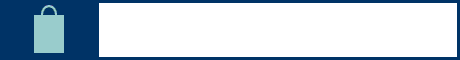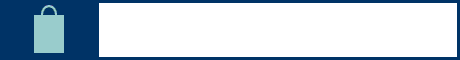|
Jeudi
4 juillet, en fin d’après-midi, s’est déroulé
à Bidart une émouvante cérémonie du
souvenir. Après une messe, célébrée
par l’abbé Mikel Epalza et chantée par la chorale
des anciens Olaeta-Oldarra en présence du Lehendakari Juan-José
Ibarretxe, ce dernier salua les stèles discoïdales
récemment restaurées des gudaris 1936/1937
décédés à l’hôpital aménagé
à Bidart par le gouvernement basque.
Au cœur de la
guerre faite aux Basques, Jean-Claude Larronde restitua, au cours
d’une conférence à l’hôtel Elizaldia, ce moment
particulièrement douloureux, mais par bien des côtés
exemplaire, de l’hôpital basque de « La Roseraie »
à Bidart, dont un résumé est reproduit ci-dessous.
 De
toutes les Institutions créées sur le sol français
par le gouvernement basque à partir de 1937 pour soutenir
ses réfugiés, « La Roseraie » fut
certainement la plus importante et la plus réussie. A juste
titre, le gouvernement basque en exil put considérer avec
fierté et un orgueil légitime cette œuvre qui symbolisait
ses capacités d’administration en même temps qu’elle
témoignait du profond intérêt qu’il portait
à son peuple. L’année 1937 se révéla
pour les Basques et pour leur gouvernement autonome fidèle
à la seconde République espagnole, le gouvernement
d’Euzkadi (constitué le 7 octobre précédent),
comme une année noire à bien des égards.
La pression des troupes rebelles franquistes ne laissa guère
de répit à ce gouvernement. De
toutes les Institutions créées sur le sol français
par le gouvernement basque à partir de 1937 pour soutenir
ses réfugiés, « La Roseraie » fut
certainement la plus importante et la plus réussie. A juste
titre, le gouvernement basque en exil put considérer avec
fierté et un orgueil légitime cette œuvre qui symbolisait
ses capacités d’administration en même temps qu’elle
témoignait du profond intérêt qu’il portait
à son peuple. L’année 1937 se révéla
pour les Basques et pour leur gouvernement autonome fidèle
à la seconde République espagnole, le gouvernement
d’Euzkadi (constitué le 7 octobre précédent),
comme une année noire à bien des égards.
La pression des troupes rebelles franquistes ne laissa guère
de répit à ce gouvernement.
Malgré
leur courage, les combattants basques, les Gudari, privés
de toute aviation, avaient été vaincus par la supériorité
militaire et surtout aérienne des forces coalisées
franquistes, allemandes et italiennes. Le Président du
gouvernement d’Euzkadi, José Antonio Aguirre était
resté jusqu’au dernier moment à la tête de
ses troupes. Il installa aussitôt son gouvernement en Catalogne
pour continuer la lutte contre le franquisme. Une des plus importantes
conséquences de cette offensive victorieuse franquiste
fut l’exil d’une grande partie du peuple basque du sud des Pyrénées.
En même
temps que les civils, furent évacués des soldats
qui, du fait de la guerre, avaient été blessés
ou mutilés. Le 20 août 1937, un bateau sort du port
de Santander, en direction de celui de Bayonne avec à son
bord 400 blessés ou mutilés. C’est pour les accueillir
et les soigner que le gouvernement loua un vaste immeuble promptement
aménagé en hôpital à Bidart, quartier
d’Ilbarritz, à environ trois kilomètres du centre
du village et aux portes de Biarritz. « La Roseraie »
de Bidart a symbolisé et symbolise encore l’effort de 1937
à 1940 des Basques vaincus militairement par les forces
fascistes, mais non abattus ou résignés.
L’organisation
de cet exil fit l’admiration de nombreux observateurs. Le journaliste
Pierre Dumas de la Petite Gironde écrivit :
« Or, bien rares dans l’Histoire sont les groupements
humains qui aient offert de plus beaux exemples de solidarité
et d’esprit d’organisation que les Basques obligés d’abandonner
leurs provinces… On peut dire que jamais on ne vit un exil mieux
organisé ». L’immeuble que le gouvernement basque
choisit pour installer l’hôpital pour gudari blessés
ou mutilés avait été jusqu’alors le siège
d’un grand hôtel. L’Hôtel de « La Roseraie »
avait été construit en 1927-1928 par l’architecte
Joseph Hiriart. Cet hôtel a été qualifié
de « plus bel ensemble Art Déco de la Côte
Basque ». L’hôtel paraissait promis à un
brillant avenir. Mais la crise économique de 1929 va ruiner
ce magnifique ensemble. « La Roseraie » ne se
révèle pas une affaire rentable et doit définitivement
fermer ses portes.
 A
l’hôpital, il y a pour l’année 1938, en permanence
une moyenne de 240 patients avec un maximum d’un peu plus de 300
blessés ou malades en même temps. Les services médicaux
et administratifs employaient au total de 70 à 80 personnes.
Il est à noter que le personnel était entièrement
basque. Si tous les services médicaux fonctionnaient normalement
et étaient dignes d’un hôpital tout à fait
moderne, une mention spéciale mérite d’être
réservée à la section de maternité
et de dispensaire pré-natal. « La Roseraie »
devint surtout le lieu d’accouchement de toute la population originaire
du Pays Basque péninsulaire réfugiée en Pays
Basque continental. J’ai dénombré dans les registres
des Archives communales de Bidart 143 naissances à « La
Roseraie ». A
l’hôpital, il y a pour l’année 1938, en permanence
une moyenne de 240 patients avec un maximum d’un peu plus de 300
blessés ou malades en même temps. Les services médicaux
et administratifs employaient au total de 70 à 80 personnes.
Il est à noter que le personnel était entièrement
basque. Si tous les services médicaux fonctionnaient normalement
et étaient dignes d’un hôpital tout à fait
moderne, une mention spéciale mérite d’être
réservée à la section de maternité
et de dispensaire pré-natal. « La Roseraie »
devint surtout le lieu d’accouchement de toute la population originaire
du Pays Basque péninsulaire réfugiée en Pays
Basque continental. J’ai dénombré dans les registres
des Archives communales de Bidart 143 naissances à « La
Roseraie ».
Cet établissement
hospitalier n’aurait pas acquis la réputation qui a été
la sienne, ni laissé un souvenir présent dans la
génération basque de l’exil s’il avait été
seulement un hôpital. Ce fut bien plus que cela, ce fut
un lieu ou se soignèrent, se cultivèrent, vécurent
et oublièrent les horreurs de la guerre, plusieurs centaines
de Basques péninsulaires réfugiés.
En effet, « La
Roseraie » fut aussi un centre de vie fonctionnel. Les
ateliers de rééducation créés en janvier
1938 se proposaient de rééduquer les invalides et
de les réadapter à des professions ou métiers
anciens ou nouveaux. Les ouvriers travaillaient 6 heures par jour,
étaient logés et nourris et recevaient un salaire.
Le nombre des ouvriers augmenta rapidement pour atteindre 142
en décembre 1938. Les visiteurs ne manquaient pas d’être
étonnés de voir les mutilés fabriquer leurs
propres instruments orthopédiques : « Comment
ne pas être surpris de voir les mutilés construire
pour eux-mêmes les membres dont ils manquent ? »
s’interroge par exemple le journal Euzko Deya.
« La Roseraie »
était aussi un centre d’enseignement pour ses résidents.
L’enseignement était dispensé dans un but pratique ;
il devait être efficace pour la vie professionnelle.
« La chorale
de ‘La Roseraie’ », ou selon son appellation officielle
« La chorale des blessés et mutilés de guerre
d’Euzkadi » a largement contribué à la
réputation de l’hôpital et est restée dans
beaucoup de mémoires. Les habitants de Bidart en particulier
ont gardé le souvenir des prestations de cette chorale,
soit à l’église pour les fêtes religieuses,
soit sur le fronton de la place de Bidart, soit devant la mairie,
prestations toujours gratuites. Le spectacle de ces belles
voix sortant de corps éclopés, et mutilés
était particulièrement émouvant et ne laissait
personne indifférent.
Jose Antonio Aguirre,
à qui les mutilés offrirent un concert lors de sa
visite, relata : « Le jour où j’ai visité
« La Roseraie », la chorale des mutilés
a chanté en mon honneur. Peu de fois dans ma vie, j’ai
senti une émotion plus profonde. Ils chantaient leur Patrie
martyrisée comme leur corps ».
La vie religieuse
était présente, avec un aumônier qui disait
les messes dans une chapelle. Comment pourrait-il en avoir été
autrement ? José Antonio Aguirre écrivit :
« … Car le peuple basque émigra avec ses croyances
et avec ses prêtres. Ces derniers aussi étaient fils
du peuple et ils suivirent le destin des persécutés
dans l’exil comme devant le peloton d’exécution ».
La messe dominicale rassemblait beaucoup de monde, y compris des
bidartars des environs.
Aucun incident avec
la population locale n’est apporté par les témoins
de l’époque : au contraire, le maire de Bidart Michelena
déclara : « Que depuis un an environ que vivent
parmi nous les réfugiés basques de la colonie d’Euzkadi,
il n’a reçu aucune plainte contre eux. Que leur tenue a
toujours été au-dessus de tout éloge tant
de sa part que de la population. Que leurs rapports avec l’administration
ont toujours été empreints de courtoisie et du respect
de nos lois ».
Au début de
l’année 1939, l’évacuation de la Catalogne rendit
nécessaire l’aménagement d’une annexe de l’hôpital.
En mai 1939, le ministre
de l’Intérieur de la République française
donna son autorisation pour l’installation d’une annexe à
« La Roseraie », dans le château d’Ilbarritz
qui ne se trouvait qu’à 100 mètres de là.
Il s’agissait d’un vaste et magnifique château construit
en 1897 par le baron Albert de l’Espée. Ce centre était
prévu pour 1200 personnes. En fait, très vite, 230
personnes y résideront en permanence.
 Mais
il était dit que les réfugiés verraient une
nouvelle guerre, mondiale celle-là. Au moment de la déclaration
de guerre de la France et de l’Angleterre à Hitler, le
3 septembre 1939, il n’y eut aucune hésitation, ni équivoque
de la part du gouvernement basque ; celui-ci se rangea dès
le premier jour, du côté des Alliés. Par la
suite, beaucoup de réfugiés de « La Roseraie »
connaîtront le camp de concentration de Gurs, de sinistre
mémoire, à l’occasion de la rafle qui eut lieu du
18 au 25 mai 1940. Mais
il était dit que les réfugiés verraient une
nouvelle guerre, mondiale celle-là. Au moment de la déclaration
de guerre de la France et de l’Angleterre à Hitler, le
3 septembre 1939, il n’y eut aucune hésitation, ni équivoque
de la part du gouvernement basque ; celui-ci se rangea dès
le premier jour, du côté des Alliés. Par la
suite, beaucoup de réfugiés de « La Roseraie »
connaîtront le camp de concentration de Gurs, de sinistre
mémoire, à l’occasion de la rafle qui eut lieu du
18 au 25 mai 1940.
Le 22 juin 1940,
les représentants de la France et de l’Allemagne signent
la convention d’armistice. Les combats cessent le 25 juin et deux
jours plus tard, les troupes allemandes occupent la Côte
Basque. Ces dernières prennent possession immédiatement
de l’hôpital, vidé de ses anciens occupants. Le drapeau
à croix gammée remplace l’ikurrina. L’hôpital
de « La Roseraie » avait vécu.
Et pourtant, il demeurait
dans le cœur de ses anciens résidents et de beaucoup d’habitants
de la Côte Basque, dont de nombreux bidartars. Plus
que du luxueux palace, ces derniers se souvenaient de l’ancien
hôpital, où ils avaient vu, dans la période
difficile et troublée allant d’août 1937 à
juin 1940, plusieurs centaines de personnes, qu’ils avaient reconnu
être Basques comme eux, vivre dans la souffrance et dans
le malheur certes mais surtout dans une impressionnante dignité
qui les grandissait à leur yeux. Le souvenir de ces hommes
meurtris, éclopés, dotés de merveilleuses
voix –qui dans leur détresse, chantaient des chants d’amour,
de liberté, d’espoir et même de joie et chez qui,
dans leurs conversations, ne venait jamais une phrase de haine-
est resté à jamais gravé dans leur mémoire.
Aujourd’hui plusieurs noms de réfugiés, hommes et
femmes, tous décédés à « La
Roseraie » perpétuent sur des stèles discoïdales
au cimetière de Bidart, le souvenir de cette époque.
A l’orée du
XXIème siècle, en faisant restaurer ces stèles
et honorer la mémoire des résidents de « La
Roseraie », le gouvernement basque rend hommage à
une génération exemplaire, dont nous devons tous
nous attacher à être les dignes héritiers.
Jean-Claude Larronde, membre d'Eusko
Ikaskuntza - Société d'Études Basques
* Jean-Claude Larronde, La Roseraie.ko Ospitalea,
L’Hôpital de « La Roseraie », El Hospital de
« La Roseraie » 1937-1940. Editions Bidasoa, 2002,
167 p. 12 Euros (RETOURNER)
Argazkiak: Enciclopedia Auñamendi |