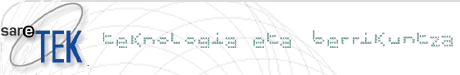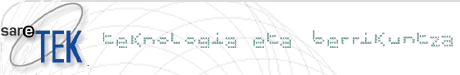|
 Le Québec est un pays de 7,4 millions d'habitants situé à l'Est de l'Amérique du Nord. Même si c'est un pays qui a beaucoup de relations avec la France, par son histoire et sa langue, nous pouvons aisément trouver des liens avec le Pays Basque. En premier lieu, nous avons les pêcheurs basques comme témoins et acteurs de ces relations entre le Pays Basque et le Québec, puis le nom d'une région "La Région des Basques" et le nom de Salaberry qui figure dans beaucoup d'endroits. Le Québec est un pays de 7,4 millions d'habitants situé à l'Est de l'Amérique du Nord. Même si c'est un pays qui a beaucoup de relations avec la France, par son histoire et sa langue, nous pouvons aisément trouver des liens avec le Pays Basque. En premier lieu, nous avons les pêcheurs basques comme témoins et acteurs de ces relations entre le Pays Basque et le Québec, puis le nom d'une région "La Région des Basques" et le nom de Salaberry qui figure dans beaucoup d'endroits.
A vrai dire, à travers le Québec et principalement dans
la ville de Montréal, les faÇons différentes
de lire le nom de Salaberry surprendraient plus d'un basque! Ainsi,
ce n'est pas difficile à Montréal, deuxième ville francophone
du monde, de rencontrer le nom de Salaberry: étant donné
que c'est le nom d'une grande avenue, des commerces, restaurants,
bars, librairies, etc... ont pris le nom de Salaberry! Comme si
cela ne suffisait pas, à côté de Montréal apparaît
une ville au nom de Salaberry-de-Valleyfield.
C'est alors que commence l'embrouille entre les différentes faÇons
de prononcer ce nom étrange! Même si le nom Salaberry était
différent des noms d'origine anglaise, franÇaise
et indienne, depuis qu'ils l'ont rattaché à un nom de consonance
anglaise, Valleyfield, Salaberry est phonétiquement devenu
"Çalabewi".
Allons faire plus ample connaissance avec ce fameux Salaberry et voir quelles sont les caractéristiques de la ville de Salaberry-de-Valleyfield!
Charles Michel d'Irumberry de Salaberry
D'après les historiens, depuis le IXème siècle, la famille Salaberry, faisait partie de la noblesse. Elle descendrait d'un membre de la famille des Rois de Navarre de cette époque. Au XVIIème et XVIIIème siècles les Salaberry, connurent la gloire au service des rois de France. L'un d'eux Louis-Charles-Victor-Vincent de Salaberry, suite à la Révolution franÇaise, mourut en 1794.
 En 1546, la famille Salaberry se divisa en deux branches et ce sont les descendants de la branche la plus jeune qui émigrèrent au Québec, deux cents ans plus tard. En 1546, la famille Salaberry se divisa en deux branches et ce sont les descendants de la branche la plus jeune qui émigrèrent au Québec, deux cents ans plus tard.
C'est de Michel de Salaberry que naquit la branche des Salaberry du Québec. Il fut capitaine de vaisseau et ses parents étaient des nobles du diocèse de Bayonne. Il fit connaissance, pour la première fois, avec le Québec en 1735 grâce à sa profession et à ses voyages. Le 30 juillet 1750, dans la ville de Beauport (près de la ville de Québec) il se maria avec Madeleine Louise Juchereau Duchesnay de Saint-Denis, également fille de nobles: fille de monsieur Beauport.
Le 5 juillet 1752 naquit un fils, Ignace Michel Louis Antoine d'Irumberry de Salaberrry. Il commenÇa ses études dans la ville de Québec puis les poursuivit en France. A l'âge de 22 ans, il retourna au Québec, capitaine dans l'armée, il s'impliqua dans la résistance contre la première invasion américaine et prit part dans la défense de la ville de Québec en 1775. Il se maria en 1778 et se fixa dans la ville de Beauport. Il devint député et conseiller au ministère de la Justice pendant 30 ans.
En 1778, naquit Charles Michel d'Irumberry de Salaberry, petit-fils de Michel de Salaberry. Il débuta sa carrière militaire à l'âge de 14 ans.
Même si, comme nous l'avons vu jusqu'à présent, la famille
Salaberry était d'origine aristocratique canadienne-franÇaise,
à partir de 1760 (le territoire de Nouvelle-France, aujourd'hui
appelé le Québec, passa sous domination anglaise)
Ignace de Salaberry et ses descendants se mirent au service des
rois d'Angleterre. Charles Michel, en octobre 1813, prit part
dans la défense historique contre les Américains.
Ces exploits le rendirent célèbre et ont contribué
à la renommée de la famille.
La victoire de Salaberry lors de la Bataille de Châteauguay
(le 26 octobre 1813)
C'est une date qui est devenue référence historique. Elle rappelle l'attaque militaire américaine qui essaya de faire reculer les frontières du Nord. Le héros, Charles-Michel d'Irumberry de Salaberry du Québec, organisa remarquablement cette résistance.
Tout commenÇa lorsque les Américains envoyèrent leur armée pour prendre Montréal: 6500 hommes prirent la direction du Nord.
Au bord de la rivière Châteauguay (à 56 km au sud-ouest de Montréal).Charles-Michel
de Salaberry lieutenant-colonel des soldats d'élite, commenÇa
à donner des ordres à sa troupe de 300 hommes. À travers les routes
principales il posa des barricades (troncs coupés etc.)
et guetta les troupes ennemies en dispersant ses hommes dans les
environs. Le général américain Wade Hampton
envoya 1500 hommes pour encercler ces "voltigeurs". Mais les Américains,
perdus dans l'obscurité du crépuscule firent un
arrêt pour attendre l'arrivée d'une autre troupe et reprendre
des forces. Salaberry n'eut aucun doute en voyant la situation
d'incertitude et de désordre de l'armée ennemie.
Pendant qu'un escadron surveillait une grande partie des hommes
de l'armée américaine bloquée par les barricades,
une autre unité assaillit les 1500 Yankees errants. Les
soldats de Salaberry firent reculer les hommes de Hampton surpris
par l'attaque et épuisés. Au même moment, le reste
des troupes de Salaberry, aidé par les indiens mohawks
(de Kahnawake, près de Montréal) et leur cris de guerre,
commenÇa à ouvrir le feu sur les américains qui
essayaient de démonter les barricades. Dans ce désordre
et ce tumulte, les 1500 soldats qui battaient en retraite vers
le gros de la troupe furent pris par les soldats américains
pour des ennemis et durent essuyer des tirs de leurs confrères!
Enfin, les hommes de Salaberry utilisèrent des sons de clairon
près des barricades et ainsi firent croire au général
Hampton que des renforts arrivaient pour défendre Montréal!
Les troupes américaines épuisées et effrayées,
aux ordres du général terrifié, prirent le
chemin du retour. C'est ainsi que Salaberry obtint la victoire
et sauva Montréal.
Depuis lors, Salaberry, le canadien-franÇais, devint un héros national. Il obtint le poste de député du Bas-Canada (nom donné en ce temps-là, au Québec actuel) et mourut en 1829.
La ville de Salaberry-de-Valleyfield
Aujourd'hui, la ville de Salaberry-de-Valleyfield est la meilleure référence des événements et des exploits de cette époque.
A l'origine, c'était un territoire occupé par les indiens Iroquois, peu colonisé jusqu'à la fin du XVIIIème siècle. Alors, les premiers défrichements et la colonisation débutèrent. Les travaux de canalisations d'eaux animèrent la vie locale à partir de la moitié du XIXème siècle. En 1854, une fabrique de papier et une scierie mécanique s'installèrent dans les environs de la ville. Plus tard, la société Alexander Buntin acheta la fabrique de papier et se développa. C'est grâce à cette industrie que la ville de Salaberry-de-Valleyfield devint célèbre au Canada: les plus grands quotidiens du Canada étaient leurs clients.
En 1874, ils choisirent le nom de Salaberry-de-Valleyfield. Jusque là, elle s'appelait Sainte Cécile, une paroisse de 3000 habitants. Le choix d'un nom double résulte des tiraillements entre les communautés anglaises et franÇaises de l'époque. M. Dépocas, le maire, proposa le nom de Salaberry en souvenir du colonel Charles-Michel-de-Salaberry héros national. Mais Alexander Buntin avait une préférence pour Valleyfield qui rappelait un moulin célèbre (Valleyfield Mills, dans la ville de Penicuik du Midlothian en Écosse). Des discussions passionnées naquirent dans la petite salle municipale et prirent de l'ampleur au sein de la population. Le débat se termina par un accord: la décision fut prise d'associer les deux noms. Ainsi la nouvelle ville adopta le nom officiel de: Salaberry-de-Valleyfield.
Au XXème siècle, le port et les sports nautiques enrichirent la renommée et l'histoire de Salaberry-de-Valleyfield.
Aujourd'hui, près de Montréal, Salaberry-de-Valleyfield représente une ville dynamique de 27000 habitants: grâce à une industrie et un commerce actifs ainsi qu'à la valorisation de son histoire et sa géographie, par la conservation de ses monuments et ses parcs , elle devient une centre d'attraction pour la région.
Lors de la parution de nos prochains articles, à travers la langue basque, l'euskara, nous aurons l'occasion de mieux connaître l'histoire et l'environnement du Québec.
Adresses électroniques utiles pour voir des photos de
la ville
et des cartes.
Xabier Harluxet |