Laurier Turgeon : "Les habitants de Trois Pistoles sont en train de construire une identité régionale au Québec en puisant dans l’histoire basque"
Robert Scarcia, journaliste canadien résidant en Pays Basque
Comment a débuté votre intérêt pour les Basques ?
En fait cela remonte à une histoire de famille parce que mon grand-père maternel, qui était d’origine béarnaise, a émigré au Canada en 1912 en compagnie de deux amis basques qu’il avait rencontrés pendant son service militaire à Tarbes. J’avais donc entendu parler des Basques par mes grands-parents quand j’étais jeune et lorsque j’ai terminé mes études de premier cycle au Canada en Alberta, j’ai eu envie de connaître les lieux d’origine de mes grands-parents. J’ai eu l’occasion d’aller à Pau pour poursuivre mes études et l’opportunité d’aller ensuite à Bordeaux afin de préparer un doctorat. J’avais envie de travailler sur un sujet qui me permettrait de lier la région du Sud-ouest de la France, et donc le Pays Basque auquel j’étais déjà attaché, et le Canada. J’ai trouvé ce sujet d’études sur les activités des Basques dans le Golfe du Saint-Laurent. Un sujet qui n’avait pas été traité. Un sujet particulièrement important puisqu’il s’agit d’une activité qui a duré à peu près quatre siècles et qui est liée à la présence des Européens en Amérique du Nord. Pour résumer : recherche sur les racines de ma famille d’une part, intérêt scientifique de l’autre.
Quel est l’apport le plus important des Basques dans le Golfe du Saint-Laurent ?
Il y a plusieurs choses. D’abord, les Basques sont arrivés tôt, ils ont chassé la baleine, pêché la morue, et ceci avant la colonisation française puisque les premières mentions de leur présence dans les archives sont du tout début du XVIe siècle. Il s’agit d’une activité qui devient très importante au milieu du siècle. En poursuivant la baleine, les Basques sont entrés dans le Golfe du Saint Laurent, ils ont établi des contacts avec les Amérindiens et ont été les premiers à nouer des relations commerciales avec eux. Nous avons découvert, pour certaines années, jusqu'à 60 navires armés des ports de Saint-Jean-de-Luz, de Biarritz, de Bidart, d'Hendaye pour l'Amérique du Nord. Le golfe du Saint-Laurent devient au XVIe siècle un pôle d'activité européenne tout aussi important que le golfe du Mexique. D’ailleurs, le mythe fondateur des Indiens Innu de la localité de Betsiamites rend compte d’une rencontre entre un marin basque et une femme autochtone. D’autre part, nous savons que les relations commerciales étaient à grande échelle puisque les objets amenés par les Basques se retrouvent dans toute la région des Grands Lacs. Les objets de traite d'origine basque ont circulé rapidement et largement dans tout le Nord-Ouest de l'Amérique, jusqu'à la lointaine Baie d'Hudson au nord et les Grands Lacs à l'ouest et dans la vallée de l’Ohio au sud.
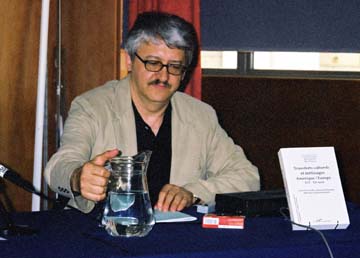 |
| Laurier Turgeon. |
De quels objets s’agissait-il ?
Il faudrait signaler surtout des objets en cuivre, le métal étant considéré comme précieux par les Indiens. Les Basques amenaient souvent des chaudrons en cuivre que les Indiens utilisaient pour faire la cuisine dans des contextes très festifs, ou bien ils découpaient ces chaudrons pour en faire des objets de parure corporelle, c’est à dire surtout des bracelets. Il y avait également des objets en fer, des couteaux, des haches, et également des vêtements. Le vin et l’eau de vie sont venus par la suite, au début il s’agissait d’objets pour décorer le corps, retrouvés dans des contextes de sépulture, sans trace d’usure puisqu’ils étaient enterrés avec les propriétaires. Il faudrait souligner que la pratique d’enterrer les objets avec leurs propriétaires est une pratique qui pénètre chez les Indiens d’Amérique du Nord avec le contact avec les Européens. Les Indiens enterraient donc ces objets d’origine européenne qui, selon leurs croyances, n’existaient pas dans l’autre monde. Leur conception de l’au-delà, faut-il le rappeler, était antérieure au contact avec les Européens.
Y a-t-il des traces linguistiques de ce contact ?
Les Indiens Micmac de l’est du Canada et de la Gaspésie, un mot de souche basque d’après certains linguistes (Kaispe), ont développé un pidgin où nous pouvons retrouver des mots d’origine basque. Il s’agit de mots destinés à pratiquer la traite, le commerce et à faciliter les échanges. Les experts parlent d’exemples comme le mot endia, pour indiquer « plusieurs choses » du basque handia « grand », ou origna pour « orignal » du basque oreina ou encore kea pour fumée et elege pour roi, du basque errege.
Comment se fait-il qu’à coté de tout cela il n’y ait pas eu de tentative pour lancer une véritable colonisation basque du Golfe du Saint-Laurent ?
Les Basques n’étaient pas des colonisateurs, ils étaient là pour pêcher la morue, chasser la baleine et faire du commerce avec les Indiens. Il s’agissait d’activités fondées sur une structure saisonnière. Même s’il existe plusieurs exemples de Basques ayant passé des hivers sur place, et cela très tôt, dès le XVIe siècle, on retrouve également certains cas, sans doute malheureux, puisque nous avons retrouvé des cimetières basques entiers notamment à Red Bay, au Labrador où 140 corps sont enterrés à différents moments. Les Basques qui passaient l’hiver avec les Indiens se tiraient d’affaire puisqu’ils suivaient les groupes amérindiens de l’intérieur des terres, ils évitaient le scorbut. Mais il n’y a pas vraiment eu de stratégie de colonisation de la part des Basques, aussi parce que la colonisation demande de grands moyens et généralement le soutien d’un Etat. Et comme il n’y avait pas d’Etat basque… D’ailleurs, quand Samuel de Champlain, au nom du roi de France, fonde la colonie de Québec en 1608, les Basques vont contester la colonisation puisqu’elle va court-circuiter les liens qu’ils avaient avec les Indiens. La présence basque était tellement visible le long de l’estuaire du Saint Laurent que le même Champlain appelait les côtes du Labrador Nouvelle Biscaye.
 |
| Robert Scarcia et Laurier Turgeon. |
Court-circuiter comment ?
Dès lors que les Français ont établi la colonie de Québec, les Basques ont étés coupés des Indiens avec qui ils traitaient depuis longtemps. Plusieurs procès eurent lieu et même des tentatives pour assassiner Champlain qui était le gouverneur de la Nouvelle France. Il y eut une période très trouble et les Basques furent progressivement écartés de la traite avec les Indiens. Ils continuent pêcher la morue. La chasse à la baleine d’autre part, à partir du XVIIe siècle, va être pratiquée de plus en plus au Spitzberg et au Groënland.
Laissons de côté l’histoire ancienne, que pensent aujourd’hui les Québécois des Basques ?
Il y a un grand intérêt, une grande curiosité pour cette ancienne présence basque. Alors qu’il est certain que les Basques étaient en Amérique avant les Français, les Québécois se demandent s’ils étaient là avant même Christophe Colomb, ce qui est moins certain.
Je dirais aussi qu’il y a un intérêt pour les Pays basques contemporains au niveau de la politique, au niveau de souverainisme. Au Québec il y a aussi un mouvement souverainiste, je dirais qu’il y a un sentiment de parenté dans le sens où l’on partage les mêmes préoccupations d’ordre politique. Il y a finalement des efforts qui sont fait pour multiplier les échanges, jumeler les villes. Par exemple, il me semble que la ville de Trois Pistoles sur la rive sud du Saint-Laurent est jumelée avec Ciboure ou Saint-Jean-de-Luz.
Parlons-en de Trois Pistoles, que se passe-il en réalité là-bas ?
Des fouilles archéologiques conduites sur une petite île du Saint-Laurent, nommée l'Île aux Basques, ont mis à jour des fours servant à la fonte des huiles de baleine, des outils employés pour la chasse, des aires d'habitation et de travail, des objets domestiques d'origine basque, des objets de traite, ainsi que des vestiges amérindiens qui laissent croire que les deux groupes ont cohabité sur le même site. L'Île aux Basques, le plus ancien site européen de l'estuaire du Saint-Laurent, a servi de tête de pont aux opérations commerciales basques en Amérique du Nord. Trois Pistoles est une petite ville à 6 Km de l’Île aux Basques sur la rive sud du Saint-Laurent, où déjà au début du XXe siècle il y a des érudits locaux qui essayent de mieux comprendre l’histoire des Basques sur cette île. Dans cette région de Trois Pistoles existe une tradition orale qui raconte l’expérience des Basques. Il s’agit d’un fait important puisque sur une vingtaine de sites archéologiques basques au Canada, cette région est la seule où subsiste une tradition orale qui parle de l’héritage basque. En 1971, René Bélanger avait écrit un premier ouvrage sur les Basques dans l’estuaire du Saint Laurent. Suite aux études faites sur les fonds d’archives par moi-même et par Selma Barkham en Espagne, l’intérêt n’a cessé de croître.
 |
| M. Lafourcade et L. Turgeon. |
En 1929, l’Île aux Basques a été achetée par la Société Provencher, une société d’histoire naturelle qui voulait étudier les oiseaux migrateurs faisant étape sur l’Île aux Basques. Vous voyez par conséquent que l’île était déjà protégée en raison de sa faune. En 1940, à l’intérêt faunique s’ajoute l’intérêt historique lié aux fours des chasseurs de baleines.
Dans votre dernier livre, Patrimoines Métissés…, vous parlez d’une ‘ethnoscopie’ basque au Québec. Qu’entendez-vous par-là ?
C’est finalement la constitution d’un paysage culturel qui renvoie au Pays Basque. C’est un mot qui renvoie à la scopie, à l’image. Les fours basques sur l’île ont conduit à la construction d’un musée et au lancement du Centre d’Interprétation de l’Aventure Basque en Amérique. Le centre a permis d’accueillir des gens du Pays Basque et de multiplier les contacts.
Ce que nous observons dans la région de Trois Pistoles est une récupération de cette histoire ancienne par la population actuelle. Une identité régionale se constitue à partir d’éléments d’emprunt. Les gens de Trois Pistoles ont construit l’identité de leur région à partir d’un héritage basque qui a disparu en fait, puisqu’il s’agit d’une présence historique. Moi qui ne connaissait pas cette région, j’étais étonné de voir que sur les annuaires il n y avait pas de noms basques : les habitants d’aujourd’hui ne sont pas des descendants de Basques, les noms sont surtout de souche normande. Ça n’empêche que l’identité régionale contemporaine puise sur l’histoire des Basques. Un exemple : un fronton de pelote basque a été construit à côté du musée du centre d’interprétation. Personne ne pratiquait la pelote à Trois Pistoles avant le fronton, maintenant, pendant l’été, il y a des tournois, avec parfois la participation d’équipes basques. Mais pendant l’hiver, les habitants de la ville font de la pelote… sur des patins. Voilà une adaptation d’un sport basque à nos hivers canadiens…
 Que
souhaitez – vous pour les relations à venir entre Québécois
et Basques, même au-delà de l’expérience de Trois
Pistoles ?
Que
souhaitez – vous pour les relations à venir entre Québécois
et Basques, même au-delà de l’expérience de Trois
Pistoles ?
J’espère un rapprochement culturel et social entre Québécois et Basques, donc une histoire qui nous unit, un intérêt pour les questions liées à la pêche et pour le patrimoine maritime. Il est possible également que nous ayons des préoccupations communes d’ordre politique. Il y a donc l’histoire, un intérêt pour la pêche et le domaine maritime et également actuellement un intérêt pour les problèmes politiques même si les enjeux sont différents puisqu’au Québec nous défendons la langue française alors que les Basques essayent de se défendre de la langue française…
Ceci dit, la question de la défense d’une langue minoritaire est la même.
Laurier Turgeon
Professeur titulaire d'ethnologie et d'histoire à l'Université
Laval (Québec, Canada), il a dirigé le CELAT (Centre interuniversitaire
d'études sur les lettres, les arts et les traditions) de 1994 à
2000 et il est actuellement rédacteur en chef de la revue Ethnologies.
Laurier Turgeon a publié de nombreux articles sur les transferts culturels
et les métissages dans des revues canadiennes, américaines et
françaises. En tant que directeur de publication, il a fait paraître
Transferts culturels et métissages Amérique-Europe, XVIe-XXe
siècle (Presses de l'Université Laval, 1996, réédition
1999) en collaboration avec Denys Delâge et Réal Ouellet, Les
espaces de l'identité (Presses de l'Université Laval, 1997)
en collaboration avec Jocelyn Létourneau et Khadiyatoulah Fall, Les
entre-lieux de la culture (Presses de l'Université Laval et L'Harmattan,
1998) et Regards croisés sur le métissage (Presses
de l'Université Laval, 2002).
Laurier Turgeon a écrit sa thèse de doctorat de 3e cycle en
1982 « Pêches Basques en Atlantique Nord (XVIIe-XVIIIe siècles).
Etude d’économie maritime ». Université de
Bordeaux III. Son dernier ouvrage est le livre Patrimoines Métissés,
Editions de la Maison des sciences de l’homme, Paris, Les Presses de
l’Université Laval.
euskonews@euskonews.com
