L’évolution du basque standard dans la littérature du Pays Basque nord, ces cinquante dernières années
Texa
HAICAGUERRE
Itzulpena euskaraz
 |
|
| Image d´Eizaguirre. |
ous savons tous dans quelle situation particulière se trouve le Pays Basque : il est divisé entre l’état espagnol, et l’état français. La langue basque porte les marques de cette séparation étatique. En effet, alors que le basque est officiel au Pays Basque sud, il est à peine reconnu au Pays Basque nord. De plus, il faut rappeler que le basque se compose de différents dialectes. Ces éléments sont des facteurs de division interne de la langue qui la mettent en situation critique.
Décidés à y faire face, les Basques et bascophiles commencèrent à se réunir dès le XVII° siècle. Un des principaux résultats de ces réunions a été la création d’une académie de défense de la langue basque, appelée Euskaltzaindia, en 1918. Elle fut basée sur trois axes de travail : la réglementation de l’orthographe, la composition d’un dictionnaire en langue basque, et l’unification de la langue basque. Ce dernier point fut au cœur de nombreux débats.
Chaque dialecte eut ses partisans, mais les plus nombreux défendirent le guipuscoan, d’un côté, et le navarro-labourdin, de l’autre. Les premiers mirent en avant la situation géographique avantageuse du Gipuzkoa : le guipuscoan était donc le seul dialecte à être en contact avec les autres. Les seconds s’appuyèrent sur la forte valeur de tradition du navarro-labourdin : Pedro Axular, par exemple, choisit ce modèle pour écrire son fameux Gero, en 1643.
 |
|
| Pierre Narbaitz Caillava. |
Depuis 1968, ce modèle standard a été enseigné et étendu aux quatre coins du Pays Basque. On peut dire que, dans un premier temps, la normalisation du basque unifié s’est effectuée au niveau de la littérature. Mais, il y a de nombreux autres facteurs comme l’école, la presse, les radios, et la télévision, par exemple. On pourrait même dire qu’à présent ces facteurs ont plus de poids que la littérature. Au Pays Basque nord, par exemple, un très grand nombre de personnes écoutent les radios basques pour participer aux jeux, pour écouter les informations ou autres émissions proposées. Ces facteurs-ci, peut-être sans le vouloir, étendent leur propre modèle standard. Mais, revenons-en à la littérature.
Le Pays Basque nord possédait déjà son basque standard réunissant le souletin, le bas navarrais, et le labourdin : il s’agit du navarro-labourdin.
Il est intéressant d’observer comment s’est effectuée la rencontre entre ce modèle standard du Pays Basque nord, et le basque unifié. Pour cela, je me suis intéressée à six auteurs du Pays Basque nord, de ces cinquante dernières années. Ainsi, vous trouverez, dans ce travail, une analyse rapide des œuvres suivantes : Kattalinen gogoetak de Piarres Narbaitz « Arradoy » (1955), Aihen ahula de Daniel Landart (1978), Gauaren atzekaldean de Manex Erdozaintzi-Etxart (1982), Hegiko bordatik de Janbattit Dirassar (1995), Botoiletan d’Antton Luku (1998), et 100% basque d’Itxaro Borda (2001).
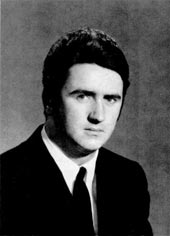 |
|
| Daniel Landart Urruti. |
Tout d’abord, on peut noter que l’œuvre de Piarres Narbaitz « Arradoy » est un peu à part, car elle est apparue en 1955, c’est-à-dire une dizaine d’années avant que les bases du basque unifié soient établies. Cependant, l’écrivain avait le navarro-labourdin comme modèle de langue littéraire.
Puis, une fois que le basque unifié fut réglementé, il fallut mettre en pratique ces règles, afin de pouvoir les enseigner, par la suite. La littérature a été le principal générateur de cet enseignement dans les années 70 et 80.
Il me semble que le livre de Daniel Landart en est un bon exemple. Deux personnes lui corrigèrent l’orthographe, le vocabulaire, et la grammaire, afin qu’il respecte au maximum les règles du basque unifié. On peut penser qu’il voulait enrichir son écriture de ce nouveau modèle.
De plus, il a rajouté un lexique à la fin du livre, comme s’il voulait faire comprendre aux lecteurs du Pays Basque sud le vocabulaire particulier à sa région natale, et vice et versa. On pourrait dire qu’il avait un but pédagogique.
Il semblerait que Manex Erdozaintzi-Etxart avait des relations avec les écrivains du Pays Basque sud. Par conséquent, on peut penser que l’utilisation du basque unifié n’ait pas été trop difficile pour lui. Cependant, il garde comme base le modèle standard du Pays Basque nord, tout en y ajoutant des éléments du basque unifié, comme le fait Daniel Landart .
 |
|
| Itxaro Borda. |
Comme s’il voulait faire face à cette tendance, Janbattit Dirassar effectue un retour à l’utilisation du modèle traditionnel navarro-labourdin. Il faut rappeler qu’il écrit également dans l’hebdomadaire Herria, qui est, précisément, le journal qui a lancé le modèle navarro-labourdin littéraire.
Ensuite, dans le cas d’Antton Luku, il ne s’agit plus de la rencontre entre le basque unifié et le navarro-labourdin, mais de la rencontre entre le basque unifié et les langues étrangères. Il semble vouloir rester fidèle au basque qui est parlé au Pays Basque nord, ou, pour être plus précise, à l’oral. La large place qu’il donne au français dans son livre peut être interprété de cette façon, entre autres.
Enfin, Itxaro Borda écrit en basque d’une autre façon encore. On peut dire qu’elle écrit de manière ludique. Le basque est son outil d’écriture, mais c’est aussi le sujet de son livre. Elle joue avec la langue basque, ou, plutôt, avec les différents dialectes basques qu’elle connaît. En effet, tout en se basant sur le basque unifié, elle intègre dans son récit du vocabulaire particulier au pays de Mixe, à la Soule, et au Pays Basque sud. En plus, comme Antton Luku, elle accorde aussi une place importante aux langues étrangères. On peut penser qu’elle veut faire une caricature de la situation linguistique actuelle, avec humour et ironie.
Donc, les premières années qui suivirent l’unification du basque, les écrivains travaillèrent en faveur de sa bonne mise en route, et de son extension. Aujourd’hui, le basque unifié est totalement normalisé, son utilisation devient plus libre, et plus ludique. Dans quelle mesure les écrivains sont-ils libres dans leurs choix d’écriture ? Par exemple, jusqu’à quel point peut-on accepter les langues étrangères, ou les dialectes dans la littérature basque ?
Premièrement, on peut remarquer que la langue basque, comme toute autre langue vivante, change en permanence. Il paraît donc naturel que du vocabulaire étranger soit intégré au lexique basque. Cependant, la littérature basque est en premier lieu la littérature écrite en basque. Il faut alors faire attention à l’importance donnée aux langues étrangères.
En ce qui concerne les dialectes, il ne faut pas oublier qu’ils constituent la richesse de la langue basque, et que, par conséquent, il ne faut pas les oublier. Cependant, il ne faudrait pas retomber dans une situation similaire à celle précédent l’unification du basque, une situation où la langue était faible à cause de ses divisions internes.
Bref, il semblerait que les débats qui naissent autour de la langue basque soient inévitables, et incessants.
