L’Amitié Québec-Euskadi
Josemari
VELEZ DE MENDIZABAL AZKARRAGA
Photographie: Pedro ZARRABEITIA
Traducteur: Jocelyne VERRET
Jatorrizko bertsioa euskaraz
Traducción al español
C’est le 23 août 1983 que j’ai eu mon premier contact avec le groupe Québec-Euskadi, au siège du gouvernement de la Communauté autonome basque, où je travaillais alors. Ce matin-là, j’ai reçu la visite de Begoña Zabala, qui m’a parlé de la troupe de théâtre montréalaise Ekin-Québec. Originaire de Bilbao, elle était membre de ce groupe et m’a expliqué qu’ils travaillaient à consolider les liens entre le Pays basque et le Québec. Elle a mentionné quelques noms qu’à ce moment-là je n’ai pas “compris”, comme si elle avait voulu démontrer le sérieux de son propos.
 |
| Montréal, 14-02-1984. Iñaki Zabala, Gaston Miron et Arantza originaire d’Azpeitia chez les Zabala. |
Le père de Begoña, Iñaki Zabala Ayerbe, était tout un personnage. Il tenait une boutique de cuir à Bilbao et avait déjà été dans le commerce du wolfram. Nationaliste convaincu, il était de ceux qui croient que nous, les Basques, devons faire entendre notre voix haut et fort dans le monde entier. De ce point de vue, nous étions absolument d’accord. Le 3 octobre de la même année, nous nous sommes rencontrés à Gasteiz et il m’a alors confié qu’il était tout à fait engagé dans les projets de sa fille, qui vivait au Québec. Il était prêt à débourser pour renforcer les relations culturelles entre nos deux peuples. Et il n’en est pas resté aux paroles, puisque c’est par son entremise que sont venus en Euskadi, pour la première fois, quelques Québécois - entre autres, le sculpteur Armand Vaillancourt, qui voulait installer une de ses oeuvres près de Guernica -; c’est Iñaki qui a payé de sa poche la location d’un avion, afin de survoler la Biscaye à la recherche d’un site approprié pour Vaillancourt. Iñaki était homme à prendre rapidement les décisions. Nous sommes restés longtemps à table, après ce déjeuner du mois d’octobre et au cours de cette longue et agréable conversation, le premier projet a pris forme: nous allions monter à Montréal une exposition du photographe bilbaïnien Pedro Zarrabeitia.
Peu après - le 21 octobre -, Iñaki et moi, en compagnie de Pedro Zarrabeitia, sommes allés à Pau. Notre objectif était d’avoir un entretien avec la chanteuse québécoise Pauline Julien, qui était amie de Begoña Zabala en plus d’être la conjointe du ministre québécois Gérald Godin. Pauline nous a superbement reçus au Casino de Pau, où elle chantait ce soir-là dans le cadre d’un festival pour promouvoir les langues minoritaires, auquel assistait Danielle Mitterrand, l’épouse du président français. Après avoir paru sur scène, Pauline nous a salués avec un retentissant “Vive le Pays basque!”. Au cours du dîner, elle nous a assurés que nous serions reçus officiellement par le gouvernement du Québec lors de notre voyage là-bas.
La voie étant préparée, nous avons décidé de faire cette première visite en février 1984. Le groupe Amitié Québec-Euskadi s’est chargé des détails de l’exposition de Pedro Zarrabeitia et a eu recours à la collaboration du collectif Omélic-Foyer artistique des communautés culturelles du Québec. Dans l’intention de présenter convenablement le Pays basque aux autorités montréalaises, nous avions traduit en français, avec le concours d’Alberto Schommer et d’Ernesto Sabato, le texte du livre “Huts”, récemment publié par le gouvernement basque; c’est cette traduction qui nous a servi de carte de visite.
L’exposition a été inaugurée le 15 février. Zarrabeitia et moi étions toutefois arrivés à Montréal trois jours auparavant. Une première grande surprise nous attendait à l’aéroport: les membres d’Amitié Québec-Euskadi étaient là, brandissant l’ikurrina (drapeau basque) pour nous accueillir. Les Zabala père et fille ont fait les premières présentations: Gaston Miron, Denise Boucher, Armand Vaillancourt, Manuel Aranguiz…
À partir de ce moment-là, ça a été une course folle, une succession ininterrompue d’événements, de visites et de réunions. Pour être tout à fait honnête, je dois avouer que nous avons aussi fait un peu de tourisme, suivant en cela les conseils éclairés de nos amis.
 |
| Montréal, 15-02-1984. Dans l’Auditorium de Montréal, entre autres Iñaki Zabala, Armand Vaillancourt et Begoña Zabala. |
Voici quelques-unes des rencontres que nous avons faites: on nous a informés du travail qui se faisait, en ce qui a trait aux langues minoritaires, au ministère de l’Éducation; nous avons longuement analysé, avec les responsables de l’Union des écrivaines et des écrivains québécois, quel genre de contacts nous pourrions favoriser avec les écrivains basques; au département d’Art dramatique de l’Université du Québec, nous avons concerté une représentation d’un groupe de théâtre basque; nous avons discuté avec la direction d’un musée d’art de Montréal d’une éventuelle exposition permanente d’un artiste basque; à l’Association des cinéastes québécois, nous avons parlé d’organiser une projection de films québécois au festival de cinéma de Donostia (Saint-Sébastien); j’ai profité de mon entretien avec le ministre de la Culture, Clément Richard, pour l’inviter à venir au Pays basque; nous avons visité les rédactions des chaînes de télévision Radio-Canada et Radio-Québec et celle du quotidien Le Devoir ; et beaucoup d’autres rencontres.
Parmi tous ces contacts, j’ai particulièrement apprécié les échanges d’idées et de points de vue avec Gaston Miron et Denise Boucher, de l’Amitié Québec-Euskadi. Jusque-là, j’ignorais que Gaston était considéré comme un poète national et qu’il avait remporté les prix les plus prestigieux de la littérature française. Denise, pour sa part, auteur dramatique de haut niveau et féministe convaincue, écrivait les poèmes des chansons de la réputée Pauline Julien et d’autres chanteurs. Mais par-dessus tout, dans tous leurs témoignages, ces deux amis montraient leur sentiment d’appartenance à un peuple; c’est pour cela qu’ils admiraient le Pays basque, pour la fierté avec laquelle il essaie de perdurer, en tant que nation, au sein d’une civilisation occidentale en déclin. Gaston Miron n’était pas très optimiste quant à la possibilité pour le Québec, dans l’avenir, d’obtenir son indépendance du Canada. Il craignait que la conscience d’être un peuple à part entière ne fût en train de s’émousser.
Manuel Aranguiz, que j’ai mentionné plus haut, était membre de ce groupe. Chilien, né à Santiago, il vivait en exil suite au coup d’état de Pinochet. Il habitait le Québec depuis 1974. Acteur et écrivain de profession, il m’avait offert en cadeau un de ses magnifiques recueils de poèmes, “Cuerpo de silencio”. Je lui ai posé des questions sur son nom basque, mais il ne savait pas grand chose à ce sujet. Par contre, nous avons longuement parlé des indiens Mapuches. Mais c’était, de toute évidence, le cinéma qui l’attirait le plus.
Et le jour du vernissage de l’exposition de Zarrabeitia est arrivé, bien sûr. La galerie d’art Convergence était pleine à craquer. C’était quelque chose! Je n’ai jamais plus vécu de happening comme celui-là, nulle part. Denise et Armand ont fait des conférences enflammées, la salle s’est remplie de personnages singuliers et extravagants, l’atmosphère était saturée d’effluves de marijuana et le whisky déliait les langues… et les corps. Pendant que les journalistes se promenaient d’un côté à l’autre, tout à coup, Vaillancourt a fait entrer dans la salle un camion chargé de bois coupé, l’a déchargé sur place et s’est mis à tailler une sculpture, sous un tonnerre d’applaudissements. Je n’ai jamais demandé à Pedro Zarrabeitia quelle influence avait eue cette exposition sur sa carrière artistique. Les médias, quant à eux, ont couvert l’événement de manière exceptionnelle et cette première manifestation conjointe du Québec et du Pays basque est restée gravée en moi pour toujours.
L’écho de ces journées culturelles a bien sûr atteint l’Espagne et un mois plus tard, il s’est produit une chose intéressante. Le 15 mars, le couple royal espagnol est venu à Montréal et a été accueilli par le Premier ministre du Québec, René Lévesque. Après la réception, les journalistes espagnols ont demandé à Lévesque si son gouvernement n’était pas en relations avec une région d’Espagne. Le Premier ministre aurait alors mentionné la Catalogne. Cette réponse a provoqué une violente réaction chez certains des journalistes qui arboraient à la poitrine le drapeau espagnol. Le lendemain, les quotidiens El Diario Vasco et El Correo Español déclaraient, sous le titre “Lévesque n’a pas voulu mentionner la visite que le vice-conseiller à la Culture du gouvernement basque a faite au Québec”: “Lévesque a dit, après son entrevue avec Juan Carlos: “Nous n’avons pas de relations avec les Basques”, même si ce n’était pas la vérité. Le vice-conseiller à la Culture du gouvernement basque, Vélez de Mendizabal, a visité le Québec en février. Lévesque, un politicien cynique, n’avait pas intérêt à faire mention des Basques au cours de la visite royale.”
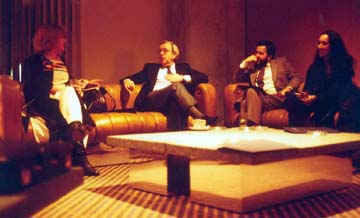 |
| Montréal, 15-02-1984. Avec le directeur de l’Auditorium de Montréal, Denise Boucher et Begoña Zabala. |
À la lecture de ces lignes, il m’a paru évident que l’événement de Québec en avait valu la peine. Je n’aurais même jamais pu imaginer, lorsque nous en avons commencé les préparatifs, que cette activité sans prétentions aurait un tel écho.
À notre retour du Québec, le programme a suivi son cours au Pays basque. Euskal Telebista et Radio-Québec ont signé une entente et, sous le titre “Légendes du monde”, on a porté au cinéma les contes de différentes régions de la planète. La première a eu lieu au siège de la Délégation générale du Québec à Paris, le 24 octobre 1984. Deux jours plus tard, Pauline Julien donnait son premier concert au théâtre Miramar de Donostia. Le lendemain, elle chantait à Bilbao. Parmi les nombreuses chansons de son répertoire, elle a choisi de nous dédier le texte de Brecht “Bilbao Song”. Par la suite, je n’ai plus eu de ses nouvelles, jusqu’à sa disparition en 1998. C’est dans une revue culturelle que j’ai appris son décès.
J’ai aussi eu quelques contacts avec Denise Boucher. Elle est venue une fois au Festival de théâtre de Sitges, en qualité de membre du jury, et nous avons alors conversé au téléphone. J’ai su plus tard qu’elle avait été nommée présidente de l’Union des écrivaines et des écrivains québécois. Je n’ai pas de nouvelles de Vaillancourt, ni de Manuel Aranguiz. Quant à Begoña Zabala, même si nous nous sommes perdus de vue depuis des années, il paraît que je pourrais retrouver sa trace par l’entremise de sa fille Miren, qui assiste aux cours de basque qui sont offerts au Québec.
J’ai eu une relation plus suivie avec Gaston Miron. Il m’avait fait parvenir une invitation pour assister à l’hommage que la Maison de la poésie allait lui rendre à Paris, en juin 1984. Je n’ai pas pu y aller, mais nous avons parlé au téléphone et je lui ai demandé de me rendre un service: je voulais entrer en contact avec Édouard Glissant, le Martiniquais qui était chef de rédaction de la Revue de l’Unesco; nous voulions éditer une version en basque de la revue, et Glissant était la personne-clé pour ce projet. Il devait participer à la cérémonie en l’honneur de Gaston et ce dernier m’a donné sa parole qu’il lui transmettrait le message. Le travail d’intermédiaire a porté fruit puisque, peu de temps après, Glissant m’a reçu au siège de l’Unesco à Paris. La version en basque était lancée; nous en avons fait la présentation à Donostia, en mars 1985. Cela a été mon dernier acte officiel au sein du gouvernement basque. Mon ultime rencontre avec Gaston a eu lieu en 1985, à l’Expo-Langues, alors que j’étais président de l’Association des écrivains basques. C’est dans le journal Le Monde que j’ai appris la mort de Gaston Miron, en décembre 1996.
Quand Garaikoetxea a été démis, nous avons dû quitter le gouvernement basque et il semble bien que ceux qui ont pris notre place - comme il est coutume dans ces cas-là - ont enterré ce que leurs prédécesseurs avaient mis sur pied. Apparemment, ils n’ont pas jugé intéressant le travail d’Amitié Québec-Euskadi. Comme, d’une part, les reprises sont toujours décevantes; et que, d’autre part, il est impossible de réunir à nouveau l’équipe de 1984, le retour sur le passé ne sert strictement qu’à en écrire la chronique comme il se doit. Cependant, les esprits ne meurent jamais et le milieu basque qu’on retrouve, aujourd’hui, à Montréal devrait reprendre le flambeau de ces hommes et de ces femmes, et entreprendre de construire des ponts et d’y jeter un nouvel éclairage. Voilà le défi à relever, mes amis!
